Grandir, mais pas trop vite
En route vers les élections municipales
Nos municipalités grandissent, peut-être trop rapidement à l’avis de certains citoyens. Mais pour rester en santé et continuer d’offrir des services de qualité à leurs résidents, les municipalités n’ont pas vraiment le choix : elles doivent grandir. La question est plutôt comment. Discussion avec Gérard Beaudet, professeur titulaire à l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage de l’Université de Montréal.
« Quand une ville accueille des nouveaux développements, les nouvelles taxes qui seront perçues sont rarement fondées sur un calcul exhaustif des services dont on aura besoin. Lorsqu’on franchit un certain seuil, tout à coup la station de pompage n’est plus assez grosse, la bibliothèque a besoin d’une succursale, etc. On est obligé d’investir, mais comme on n’a pas prévu les coûts, on est coincé. Les municipalités sont toujours en retard d’un projet », illustre M. Beaudet.
Ainsi, la municipalité doit démarrer un nouveau développement pour se financer. Mais quelques années plus tard, lorsqu’il
est terminé et que les nouveaux résidents sont installés, ceux-ci mettent encore de la pression sur les services municipaux. Et le cycle recommence.
Trop vite
Une municipalité peut cependant grandir trop rapidement. Dans les Laurentides, par exemple, beaucoup de propriétés appartiennent à des villégiateurs. Ceux-ci viennent dans la région à l’occasion ou pendant les fins de semaine. Mais si beaucoup d’entre eux décident de s’installer de façon permanente dans la région dans un court lapse de temps, comme lors d’une vague de départs à la retraite ou durant la pandémie, cela peut causer des problèmes.
« Si la population double du jour au lendemain, avec tous les services que la municipalité doit donner à ses citoyens, et que le contexte fiscal n’est pas adapté ou adaptable rapidement, ça peut déstabiliser la municipalité. C’est vrai sur le plan financier, mais aussi organisationnel et de la main d’œuvre, pour augmenter la capacité à donner des services », explique le professeur.
Stagnation
À l’inverse, une municipalité pourrait décider de suspendre ou de limiter sa croissance, pour réévaluer son plan de développement. C’est ce qu’a fait récemment Sainte-Anne-des-Lacs, par exemple, en gelant temporairement l’émission de certains permis. Mais il y a un risque, prévient M. Beaudet.
« On peut adapter le contexte fiscal à la hausse anticipée de la valeur des propriétés, et les revenus pourraient être suffisants, en contrôlant les dépenses et sans obligation de nouveaux services. C’est vrai à court terme, quand toutes les infrastructures sont en bon état et qu’on a juste à les faire fonctionner. Mais un jour il faudra refaire la tuyauterie… et ce ne sera plus suffisant. »
« Le statut quo est très fragile, d’autant que les finances municipales reposent sur la taxe foncière. Si les sources de revenus étaient plus diversifiées, on pourrait envisager moins de développement », propose l’urbaniste émérite.
« Planifier, c’est prévoir »
Ainsi il faut prévoir, tôt ou tard, la croissance de sa municipalité. « Dans les Laurentides, la densité n’a pas nécessairement bonne presse. On n’a pas la propension à se tasser, mais plutôt à s’éparpiller, à vivre en nature », constate le professeur.
Cela veut dire s’étendre sur le territoire et donc, ironiquement, il faut remplacer des arbres par des résidences, des routes et tout ce qui vient avec. Jongler entre développement immobilier et préservation de la nature peut donc être ardu. Des projets comme le Mont-Habitant à Saint-Sauveur ou l’écoquartier à Saint-Jérôme sont d’ailleurs contestés par une mobilisation citoyenne.
L’urbaniste déplore aussi une contradiction chez les résidents. « Les gens déjà installés considèrent qu’ils se sont bien installés, mais que les nouveaux résidents vont être de trop. » Ou dit autrement : « Le paysage est exceptionnel, mais je préférerais qu’on ne soit pas trop à le partager. »
C’est pourquoi la réglementation municipale doit encadrer et prévoir son futur développement, en prenant en compte les préoccupations des résidents. « Est-ce qu’on est capable d’accueillir de nouveaux résidents, dans des conditions acceptables pour les citoyens? Il faut qu’ils soient reçus convenablement et avec enthousiasme, sans perturber ou susciter la grogne. »
Certains élus se disent pris au dépourvu lorsque la réglementation municipale, trop permissive, les obligent à accepter tel ou tel projet. Mais pour M. Beaudet, ce n’est pas une excuse. « Planifier, c’est prévoir », conclut-il.
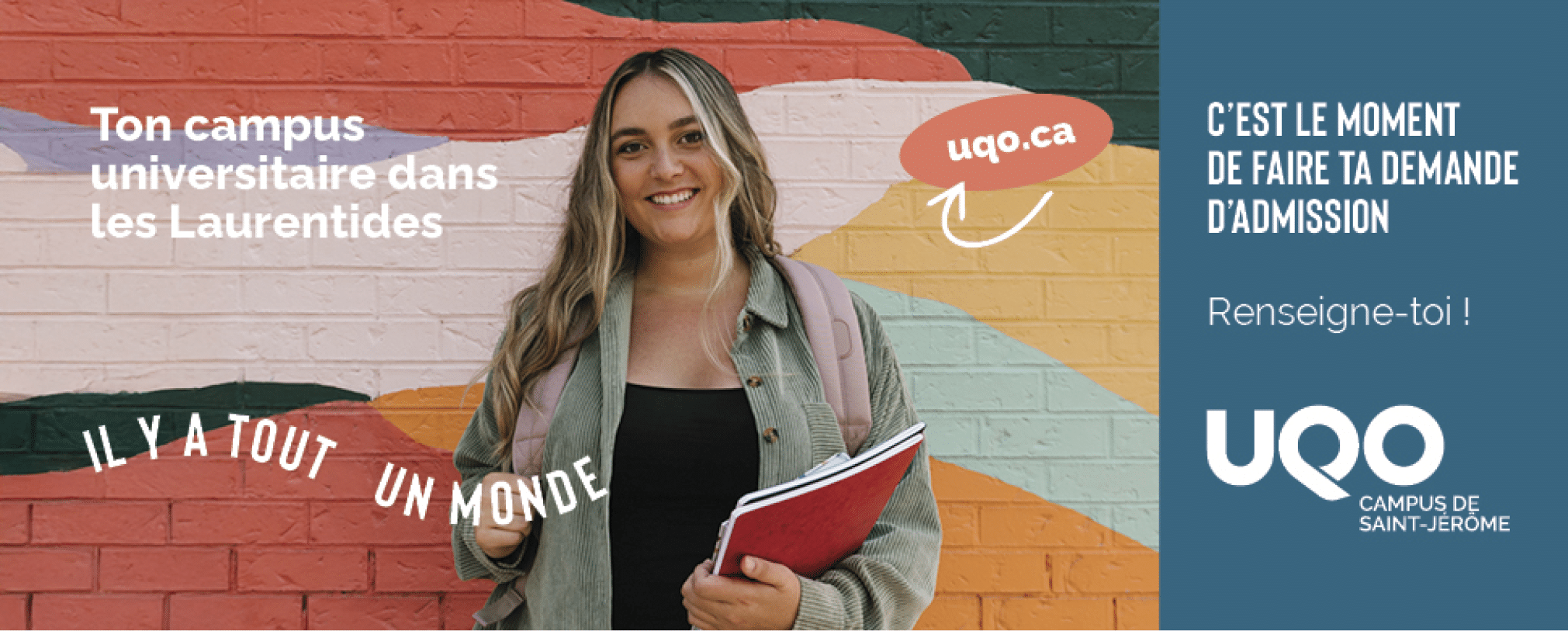








2 commentaires
Personnellement, j’aurais beaucoup de plaisir à relever un défi de croissance rapide dans ma municipalité – Wentworth-Nord – car nous avons les conditions optimales pour le faire.
Notre territoire est vaste (environ 8 habitants / par kilomètre carré) et notre centaine de lacs fait le bonheur de bien du monde. De plus, nous n’avons pas de coûteux services d’égout ou d’usines de traitement des eaux. Chez-nous, près de deux propriétaires sur trois sont des villégiateurs et leur arrivée en masse ne nous obligerait donc pas à construire de nouvelles routes.
Le plus grand malheur serait de constater que les services de proximité sont quasi inexistants car la demande est actuellement trop faible pour assurer leur survie. Mais l’arrivée d’une masse critique d’autant de personnes nous forcerait à implanter ces services, pour le grand bonheur des résidents permanents actuels.
Bref, ce serait une situation gagnant-gagnant !
Danielle Desjardins
en effet palnifier est 1 atout mais aussi les villes doivnet s assurer que les nouvelles constructions s’harmonise avec l environement actuel. chose qie je ne comprends pas les gens de la ville cherchent des ŝtyles de propriétées qui ressembletna ce qu ils ont deja et non un style refletan tle cachet des Laurentides pas des styles que l on retrouve a Blainville ou LorraineL autre probleme de grandir trop vite est l auturoute 15 nord qui ne convient plus du tout a l achalandage que Mirabel et autre municipalité on crée, au moins si la 13 aallait jusqu a aututoute 50 il y aurait un peu de relache sur la 15.